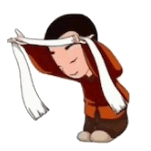Shantideva’s
Bodhicharyāvatāra
བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ།།
Groupe d'Etude guidé par Vén. Lama Sangyay Tendzin
Session 58 - Samedi 10 décembre 2022
Chapitre SIX : Cultiver la Patience
Questions & Réponses : Session 2
REFUGE | MANDALA | REQUETE des ENSEIGNEMENTS
Invocation par le Lama de l’assemblée des Bouddhas et des détenteurs de Lignée.
Courte pratique de Quiétude Mentale – Développement de la Bodhicitta
Tashi Deleg !
Lors de la session précédente, nous avons défini la colère et ses manifestations variées comme étant des formations mentales (‘Samskaras’) appartenant aux événements mentaux négatifs causant la souffrance et la destruction du mérite dont nous avons besoin pour atteindre la bouddhéité.
Ayant donc identifié le problème majeur que nous devons résoudre afin de progresser sur la voie de l’éveil, nous avons conclu sur la nécessité d’y faire face et de gagner la maitrise de notre esprit par un entrainement systématique.
Cet entrainement concerne l’abandon de toute forme de réaction à nos expériences, comme nous le démontre Shantideva dans les strophes 27 à 29 revisitées dans les questions 4 & 5 que nous aborderons sous peu.
Question 3 - Strophes 12 à 24 :
Serait-ce le besoin de changement ressenti par les êtres, qui deviendrait un frein à pratiquer la vertu de la patience de manière stable et constante ?
Réponse :
La question dénonce un peu un manque d'étude approfondie des strophes concernées. Par souci de gain de temps, je ne les ai pas reproduites ici.
Dans l’ensemble, elles témoignent toutes de la nécessité absolue de clore le débat et d'engager sans paresse l'entraînement de l’esprit par la maitrise de la patience.
La réponse est liée à et fut re2pondue par ce qui a été enseigné lors de la session précédente.
Elle se confirme par l’analyse et le raisonnement commentés par Shantideva dans les strophes suivantes.
Questions 4, 5 & 6 - Strophes 27 à 29 :
Strophe 27 :
Ce que d’aucuns (L’école Sāṃkhya) voient comme la « nature primordiale »,
De même que le concept de « soi ».
Cela n’accède pas à l’existence
En projetant d’exister.
Strophe 28 :
Ce qui n’est pas né n’existe pas :
Comment cela pourrait-il aspirer à l’être ?
Se portant continuellement vers son objet,
Le soi ne cesserait jamais de le percevoir.
Strophe 29 :
Si le soi est statique et non sensible, (comme l’affirme l’école Nyaya)
Il est forcément inactif comme l’espace.
Entrerait-il en contact avec une cause étrangère,
Quelle action cette dernière aurait-elle sur l’immuable ?
Question 4 :
En ce qui concerne la culture de la patience par rapport à la réalité ultime des choses, Lama peut-il expliquer un peu plus sur les strophes 27-29 ?
Réponse :
Comme nous y invite Sa Sainteté Karmapa dans les enseignements d’été du mantra secret, l’étude approfondie des enseignements du Bouddha requiert de se pencher sur les différentes philosophies indiennes présentes lors de son avènement et sur les modes de raisonnement logique non-dualistes.
Dans les strophes 27 à 29, Shantideva réfute l’existence d’un soi permanent en démontrant l’invalidité des principes fondamentaux de deux des six écoles philosophiques indiennes dites orthodoxes, l’école Sāṃkhya (*) et l’école Nyaya (**), basés sur la croyance en l’atman ou le soi permanent.
(*) L’école Sāṃkhya est basée sur une analyse rationnelle de la réalité dont l’aboutissement conduit à la libération du samsara.
Dans la philosophie indienne du Sāṃkhya, la cause originelle des phénomènes du monde matériel est d‘abord leur Nature Primordiale (prakṛti) ; mais c'est aussi la Nature Originelle combinant les potentialités de l'Énergie et de la Matière. Le principe femelle dynamique est activé par le contact du principe mâle statique, l'Esprit.
Le devenir moral de l’individu est considéré comme une création de l’intellect l’orientant selon huit pôles :
- S’il est ‘vertueux’, c’est-à-dire s’il accomplit ses devoirs (le dharma socioreligieux de cette école), il monte dans la hiérarchie des êtres.
- S’il n’est pas vertueux, il descend.
- S’il est doué de ‘souveraineté’, c’est-à-dire de pouvoirs (force dans la sphère animale, pouvoir dans la sphère humaine et pouvoirs magiques dans la sphère céleste), il ne rencontre pas d’obstacle.
- Le contraire s’il ne possède pas de pouvoirs.
- S’il est ‘passionné’, il meurt et renaît sans cesse, à moins qu’il ne soit détaché.
- S’il atteint le non-attachement, il se dissout dans la prakṛti(ce que font les "yogis" mais qui ne constitue pas la libération selon le Sāṃkhya.
- S’il ne possède pas la connaissance, il s’enchaîne.
- Il se libère s’il possède le savoir, c’est-à-dire la connaissance pratique de la philosophie Sāṃkhya, qui doit aboutir à ce que le purusa, (l’être cosmique) comprenne qu’il n’est pas l’individu qu’il croit être, qu’il est pure conscience, et cesse de s’identifier à son appareil psychique. »
(**) L'école Nyaya soutient que la souffrance humaine résulte d'erreurs produites par une activité conduite sous l’influence d’une connaissance mauvaise ou incomplète (notions et ignorance).
La libération de la souffrance s'obtient par la connaissance juste. La fausse connaissance n'est pas simplement l'ignorance, elle inclut l'illusion. La connaissance correcte consiste à découvrir et à surmonter ses illusions et à comprendre la vraie nature de l'âme, du soi et de la réalité.
Les quatre fondements de la connaissance juste sont :
- La constatation directe dans l’observation
- L’inférence
- L’assimilation par comparaison
- Le témoignage de l’autorité
Question 5 :
Je ne parviens pas à comprendre si le soi est permanent ou non. Lama peut-il clarifier ce point ?
Réponse :
Bien qu’elles partagent certains principes avec le Bouddhisme, ces écoles possèdent des vues divergentes.
Le point établi dans le raisonnement tenu par Shantideva est la réfutation de l’existence d’un soi permanent.
L’essentiel pour nous est de considérer l’école non-dualiste du Bouddhisme initiée par Nagarjuna, selon laquelle le self, le soi, n’existe pas de façon permanente.
Question 6 :
Lama peut-Il définir le soi ?
Réponse :
Au vu des explications qui viennent d’être données, l’abandon du « je » rend de toute évidence la question, obsolète. Les jeux du « je » ne sont-ils pas tous, illusoires et fallacieux ?
Toutefois, ceci ne veut pas dire que cette question doit être ignorée. Fixez-vous plutôt l’objectif de définir ce « soi » sans avoir recours à autrui… juste par vous-même. Ceci apportera par ailleurs la seule réponse que vous pourrez valider.
Posez-vous la question de l’existence du soi que vous cherchez à définir.
Faites-le non sans vous rappeler que la réponse à cette question est quadruple :
- Oui, il existe dans la vérité relative et illusoire. Créé par besoin de survie, il répond aux caprices des êtres limités.
- Non, rien ne peut le décrire totalement.
- Oui et non, bien qu’il existe, il ne peut être identifié à quoi que ce soit.
- Ni oui, ni non, la contemplation qui dissout la question.
Nul autre que vous-même ne pourra résoudre cette énigme.
Comme un Koan zen, il ne s’agit pas d’y réfléchir par le biais d’une mentalisation sans précédent mais de s’y associer durablement pour se fondre dans “l’Eureka” de sa compréhension spontanée.
Question 7 : Strophes 53 & 54 :
Strophe 53 :
Insultes, mots cruels,
Et paroles diffamatoires
Ne peuvent blesser mon corps !
A quoi bon donc s’enrager ?
Strophe 54 :
Le dédain des autres
Ne pourront me dévorer
Ni dans cette vie ni dans la suivante !
Alors pourquoi le trouver insupportable ?
Question 7 :
Le Seigneur Shantideva pose la question : pourquoi s’enrager et pourquoi s’opposer, alors que ni notre esprit ni notre corps ne peuvent être impactés par la médisance et le jugement ?
Y’a-t-il une réponse concrète à cette question qui permette de définir la cause de ces réactions, une cause précise qu’il serait bénéfique d’identifier pour l’observer et ne plus la subir ?
Réponse :
Le fait de ne pas accepter l’ainsité des phénomènes permettant de demeurer dans un climat de gentillesse aimante provoque la mise en œuvre d’une activité mentale découlant de la saisie égocentrique de l’instant vécu.
De ce fait, nous sommes pris dans une triple métamorphose :
1. Physiquement, en réponse à la situation figée par l'ignorance de la vacuité, notre conscience mentale se retrouve étourdie dans un conflit émotionnel nous faisant perdre le contrôle de notre corps : notre respiration est altérée, nous transpirons, notre cœur s'emballe et-ainsi- de suite.
2. Verbalement, à cause de ces réactions physiques, nous perdons le contrôle et nous enfermons dans un discours incohérent voire totalement absent.
3. Mentalement, en raison de tendances inhérentes antérieures, nous saisissons ou nions la situation et nous confinons dans des zones de confort.
Question 8 :
Serait-ce l’égo ?
Answer :
La réponse est bien évidemment oui : Du fait de l'ignorance nous sommes enclins à une incapacité capable d’évoluer librement dans l’instant présent, et de percevoir spontanément les phénomènes perçus dans leur ainsité induit une saisie égocentrique comme nous venons de le décrire.
Pratiquons un instant la quiétude mentale, avant de dédier le mérite de notre étude au bénéfice de tous.