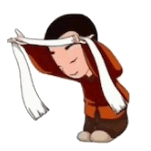Shantideva’s
Bodhicharyāvatāra
བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ།།
Groupe d'Etude guidé par Vén. Lama Sangyay Tendzin
Session 76th - Samedi 28 octobre 2023
Chapitre huit : Concentration méditative (Stabilité mentale d'une grande portée) : 187 Strophes
REFUGE | MANDALA | REQUETE des ENSEIGNEMENTS
Invocation par le Lama de l’assemblée des Bouddhas et des détenteurs de Lignée.
Courte pratique de Quiétude Mentale – Développement de la Bodhicitta
Je souhaite à tous une bienvenue de bon augure à cette 76ème session de notre étude de groupe sur le Bodhicharyâvatâra. Après avoir enquêté sur les nombreuses blessures résultant de l'attachement, Shantideva débat désormais de l'excellence de demeurer en solitude.
Strophe 85 :
Ainsi dégoûtés du désir,
Trouvons notre joie dans la solitude
Des paisibles forêts exemptes
De conflits et d’émotions négatives.
Shantidéva conseille que, découragés par notre désir de richesse matérielle et de gratification sensuelle – des éléments plus nocifs que le venin – nous devrions trouver du réconfort dans les vertus de la solitude. Dans de tels environnements isolés, les luttes pour la camaraderie et les biens matériels, ainsi que les vexations d’attachement et d’aversion, se dissolvent naturellement. C’est dans ces espaces tranquilles et vacants que les distractions cessent sans effort.
Strophe 86 :
Là, sur des rochers vastes comme des terrasses de palais,
Dans la fraîcheur de santal du clair de lune,
Les êtres fortunés qu’en silence une douce brise évente
Marchent en pensant au bien des êtres.
Dans le caractère sacré et tranquille de forêts luxuriantes, les bodhisattvas, dotés des enseignements exaltés du Dharma, résident dans de vastes havres apaisants faits de pierre monumentale et polie, baignés par la lumière rafraîchissante de la lune, plus rajeunissante que même le meilleur baume de bois de santal.
Ces praticiens spirituels se retrouvent dans un état bien supérieur à celui des rois opulents dans leurs palais odorants en bois de santal, ventilés par des éventails ornés de bijoux. Libérés des distractions des foules diurnes ou des perturbations nocturnes, ils existent dans une paisible solitude, portés par les brises douces et rafraîchissantes de la forêt.
Alors qu'un roi peut parcourir son domaine avec le souci de son amélioration, les bodhisattvas marchent résolument, leur esprit fixé uniquement sur l'amélioration d'innombrables êtres sensibles.
Strophe 87 :
Ils séjournent aussi longtemps qu’il leur plaît
Dans des cabanes abandonnées, au pied des arbres ou dans des grottes,
Libres de la souffrance d’avoir et de protéger,
À l’aise et sans souci.
Ainsi, selon Shantidéva, aspirons à demeurer dans des endroits tranquilles, à l’abri d’arbres magnifiques, ou dans des demeures non réclamées pendant de longues périodes, que ce soit des mois ou des années. Puissions-nous abandonner les fardeaux associés à la propriété d’un logement et de biens matériels.
Puisse notre existence être caractérisée par une absence de contraintes libératrice, libre de la contrainte de nous rallier aux bonnes grâces des individus d'autorité ou de protéger ceux de statut inférieur, libres de la quête du gain ou de l'appréhension du malheur.
Strophe 88 :
Être libre, sans le moindre attachement
Et sans aucun lien avec quoi que ce soit,
Voilà un bonheur et une satisfaction
Qu’Indra lui-même aurait du mal à obtenir.
La liberté d'agir sans attachements apporte un contentement sans précédent, une richesse que même Indra envierait. Le contentement surpasse toutes les autres formes de richesse, comme l'affirme le Suhrillekha : « Soyez content, car alors vous êtes vraiment riche. »
L'accent mis sur la valeur de la solitude pour favoriser la concentration méditative est délibéré. Au départ, cela nous incite à rechercher l’isolement ; plus tard, il nous soutient lorsque la solitude ou le manque de ressources nous font vaciller. Ce thème récurrent sert à renforcer notre engagement envers la solitude, prôné aussi bien par les bouddhas que par les bodhisattvas.
Shantideva se concentre maintenant sur la concentration méditative sur la Bodhicitta, en commençant par un bref lien avec la discussion précédente sur la solitude avant de plonger dans des conseils détaillés sur le sujet.
Strophe 89 :
Quand vous aurez bien réfléchi aux qualités
De la solitude en considérant tout ce qui précède,
Vos pensées s’apaiseront
Et vous méditerez sur l’esprit d’Éveil.
Shantidéva souligne l’importance d’une réflexion répétée sur les bienfaits d’une concentration sans distraction, du calme intérieur et de l’altruisme. Il prône la solitude du corps, de la parole et de l’esprit comme chemins vers un bonheur durable. En réprimant nos désirs et nos attachements, nous ouvrons la voie à la méditation sur la Bodhicitta.
Essentiellement, la maîtrise de l’étape préparatoire du premier samadhi conduit à la manifestation du samadhi lui-même. Cette maîtrise vient de l’abandon des attachements et de l’adoption du détachement, permettant une action saine.
Samadhi n'est pas le vide mental mais le contrôle total de l'esprit. Lorsqu’il est actif, il s’engage vertueusement ; quand il est immobile, il reste inébranlable.
Strophe 90 :
En premier lieu, efforçons-nous de méditer
Sur l’égalité de soi-même et d’autrui :
Puisque nous sommes égaux face au bonheur et à la souffrance,
Protégeons tous les êtres comme nous-mêmes.
Dans la pratique de la Bodhicitta relative, Shantideva identifie deux points focaux :
1) méditer sur l’égalité de soi et d’autrui, et
2) l'échange de soi et d’autrui.
Le premier sert de condition préalable au second ; sans cela, le véritable altruisme est inaccessible.
La vérité fondamentale est que tous les êtres, nous y compris, partagent un objectif commun : la recherche du bonheur et l’évitement de la souffrance. Ce point commun devrait nous pousser à cultiver l’intention de protéger les autres comme nous le ferions nous-mêmes.
Les notions de « je » et d'« autre » manquent de fondement ultime ; ce ne sont que de simples constructions mentales. Lorsqu’on se rend compte de la non-existence du « je », le concept de « l’autre » se dissout également, car il dépend du « je ».
En reconnaissant cette absence d’ego, la séparation entre soi et les autres disparaît, conduisant à une vision altruiste où les intérêts des deux deviennent inséparables.
Comprendre ce point crucial de l’absence d’ego est difficile mais décisif. Il jette les bases du dépassement de la dualité illusoire entre soi et l’autre, conduisant à une préoccupation unifiée pour le bien-être de tous.
Strophe 91 :
De même que, malgré la diversité de ses parties,
C’est l’ensemble du corps que l’on protège,
De même, les êtres dont les plaisirs et les peines diffèrent
Ne font qu’un en aspirant au bonheur comme moi.
Réfléchir au concept d’égalité implique de reconnaître l’interdépendance de tous les êtres. Tout comme vous considérez vos mains, vos pieds et vos organes internes comme faisant partie de votre corps, et donc les protégez comme tel, vous devriez également considérer tous les êtres sensibles à travers différents mondes.
Comme vous, ils recherchent également le bonheur et souhaitent éviter la souffrance. En les identifiant comme inséparables de votre propre « moi », cultivez la compassion à leur égard, tout comme pour vous-mêmes.
Considérez ceci : si on vous demande combien de corps vous avez, vous répondriez probablement que vous n’en avez qu’un, dont vous prenez grand soin. Cependant, le terme « corps » sert simplement d'étiquette pour l’ensemble de ses différents composants. Il n'y a aucune raison fondamentale d’en séparer les composants.
Par conséquent, il est intellectuellement valable d’étendre la notion du « je » pour inclure tous les êtres sensibles. À mesure que vous vous alignez mentalement sur ce sens plus large du « je », vous commencerez naturellement à prendre soin des autres de la même manière que vous prenez soin de vous-même. Ce changement de perspective pourrait être transformateur, favorisant un plus grand sentiment de compassion universelle.
Strophe 92 :
Si ma souffrance
Ne fait pas souffrir les autres,
Elle m’est insupportable
Du fait que je la crois mienne.
Comment peut-on développer une telle vision, surtout lorsque le malaise que je ressens n’est pas ressenti par les autres, et vice versa ? Une lecture de ce verset suggère que même si ma souffrance n’a pas d’impact physique sur les autres, elle reste une partie de mon identité, devenant intolérable pour moi en raison de mon attachement à elle en tant que ma propre expérience.
Strophe 93 :
De même, la souffrance des autres
Ne m’échoit point,
Mais elle est ma souffrance car,
En la prenant pour mienne, elle m’est insupportable.
Dans son commentaire, Kunzang Palden met l'accent sur les natures distinctes du corps matériel et de l'esprit immatériel, affirmant que la douleur est une construction mentale, influencée par la profondeur avec laquelle l'esprit s'identifie à son support corporel.
Cependant, cet attachement n’est pas irréversible ; grâce à une pratique habile, l’esprit peut se détacher de la souffrance physique. Cette capacité de détachement influence la façon dont les bodhisattvas sympathisent avec les souffrances d’autrui.
Ce sentiment d’attachement peut être modifié. Une fois que l’esprit passe à une compréhension empathique et non-égocentrique, l’expérience en est transformée. Ainsi, l'entraînement mental conduit au détachement personnel de la douleur physique, mais aussi au besoin naturel de soulager les souffrances d’autrui.
Strophe 94 :
Je dissiperai la souffrance des autres
Parce qu’ils souffrent comme moi ;
Je ferai le bien des autres
Parce qu’ils ont un esprit comme moi.
Pour Shantideva, l’engagement à soulager les souffrances d’autrui ne découle pas d’une obligation morale mais d’un raisonnement logique. Son objectif est d’éradiquer les formes de souffrance qui n’offrent aucun avantage ultime aux individus.
Il soutient que, tout comme l’on cherche naturellement à soulager les inconforts personnels comme la faim ou la soif, il faut également chercher à dissiper ceux d’autrui. Il insiste sur l’importance d’améliorer le bien-être d’autrui parce qu’ils sont des êtres sensibles. Cela devrait être fait de la même manière que l'on veillerait à son propre confort physique.
Strophe 95 :
Dès lors que les autres et moi-même,
Nous aspirons au bonheur pareillement,
En quoi serais-je différent d’eux au point
De ne faire effort que pour mon seul bonheur ?
Puisqu’il n’y a pas la moindre différence entre nous et les autres dans notre désir de bonheur. Pourquoi ne pourrions-nous pas travailler pour le bonheur d’autrui ? Cela n’a aucun sens de travailler uniquement dans notre propre intérêt.
Strophe 96 :
Dans la mesure où les autres et moi-même,
Nous fuyons pareillement la souffrance,
En quoi serais-je assez différent
Pour me protéger moi seul et non eux tous ?
De même, il n’y a aucune différence entre nous et les autres dans la mesure où personne ne veut expérimenter la souffrance. Alors, pour quelle raison ne pouvons-nous pas protéger les autres de la souffrance ? Cela n’a aucun sens que nous nous efforcions exclusivement de nous protéger.
Strophe 97 :
La souffrance d’autrui ne m’affecte pas :
Je n’ai pas besoin de m’en protéger.
Mes souffrances futures, elles non plus,
Ne m’affectent pas : pourquoi m’en protéger ?
Si l’on affirme : « Même si ma propre souffrance m’affecte effectivement, la souffrance d’autrui ne m’inflige pas de douleur à ce moment-là ; je n’ai donc à m’en prémunir », cette perspective mérite d’être examinée.
Même les souffrances imminentes, qu’il s’agisse de graves afflictions dans des vies futures ou de légers inconforts dans les jours à venir, ne nous causent pas de tort à ce moment précis. Si les adversités futures ne nous angoissent pas actuellement, alors l’argument selon lequel il faut se protéger uniquement semble incohérent.
Strophe 98 :
Mais elles m’affecteront !
Voilà qui est faux :
Autre celui qui meurt,
Autre celui qui renaît.
Il est crucial de comprendre que même s’il existe des liens causals entre des vies successives, il n’y a ni permanence ni discontinuité. La vision bouddhiste évite à la fois les extrêmes de l’existence éternelle et la non-existence nihiliste.
Cette compréhension nuancée relève de la vision pure et exclusive d’un esprit omniscient et doit être acceptée en s’appuyant sur les enseignements du Bouddha.
Nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Je vous invite à pratiquer quelques instants la quiescence mentale, avant de dédier le mérite de cette session au bien de tous.