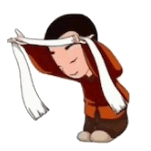Shantideva’s
Bodhicharyāvatāra
བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ།།
Groupe d'Etude guidé par Vén. Lama Sangyay Tendzin
Session 77 - Samedi 4 novembre 2023
Chapitre huit : Concentration méditative (Stabilité mentale d'une grande portée) : 187 Strophes
REFUGE | MANDALA | REQUETE des ENSEIGNEMENTS
Invocation par le Lama de l’assemblée des Bouddhas et des détenteurs de Lignée.
Courte pratique de Quiétude Mentale – Développement de la Bodhicitta
Je souhaite à tous une bienvenue de bon augure alors que nous abordons cette 77ème session de notre étude de groupe sur le Bodhicharyâvatâra. Le sujet en cours est celui de l’importance d’appliquer la concentration méditative dans la pratique de la Bodhicitta.
Strophe 99 :
Il revient à celui qui souffre
De se protéger contre la souffrance.
La douleur du pied n’étant pas celle de la main,
Pourquoi celle-ci protégerait-elle celui-là ?
On pourrait avancer que les individus traversant des épreuves devraient assumer la responsabilité de leur propre bien-être, plutôt que de compter sur les autres pour leur protection.
Ce point de vue compare l'interdépendance de la souffrance humaine à une main qui demeure indifférente à la douleur du pied lorsqu'il est blessé par une épine. Selon cette perspective, la main pourrait ne pas juger nécessaire de protéger le pied. Un tel point de vue semble toutefois manquer de cohérence logique.
Strophe 100 :
Ce n’est peut-être pas logique.
Mais c’est une conséquence de la croyance au moi.
Le « moi » et l’« autre » infondés,
Voilà précisément ce dont il faut à tout prix se libérer.
Le point de vue opposé soutient que ces actes de protection pourraient manquer de fondement logique. Cependant, en raison de l'attachement humain au soi, les individus ont naturellement tendance à veiller au bien-être de leur futur et à se soutenir mutuellement au sein de leur être physique.
En réponse, Shantideva souligne la nécessité de lâcher prise sur l'attachement excessif aux concepts de « soi » et de « autre », ou à la souffrance elle-même, car elle découle finalement d'une illusion.
Strophe 101 :
Les mots « continuum » ou « ensemble »
Sont aussi trompeurs que « collier » ou « armée ».
Il n’y a pas d’être affecté par la souffrance :
Qui donc en serait le possesseur ?
De nouveau, l'opposition suggère que bien que les vies passées et futures ne forment pas une entité unique, elles constituent une séquence continue. Malgré la différenciation entre la main et le pied, elles représentent un tout unifié, favorisant une protection mutuelle.
Shantideva n'est pas d'accord, affirmant que la séquence continue perçue ou le tout unifié sont illusoires. Une séquence continue est une accumulation de divers moments, semblables à des perles sur un collier, tandis qu'un composite n'est qu'une fusion, comme un groupe qualifié d'"armée."
Cette approche établit efficacement le concept de Non-Soi personnel, révélant que le soi, en dehors de sa singularité et permanence perçues, est entrelacé avec une illusion de continuité et d'agrégation.
Ainsi, sans réalité inhérente, il n'existe pas d'"expérimentateur" distinct de la souffrance, pas de soi personnel pour revendiquer la propriété de la douleur. Par conséquent, personne ne peut véritablement posséder une telle souffrance.
Strophe 102 :
La souffrance n’ayant pas de propriétaire
N’est celle de personne en particulier.
C’est parce qu’elle est souffrance qu’il faut l’éliminer :
À quoi bon spécifier ?
S’il n'y a pas de sujet, pas d'"expérimentateur" de la souffrance ressentie, alors distinguer entre « soi » et « autres » devient impossible. En l'absence de l'existence de l'un ou de l'autre, aucun contraste ne peut être établi entre eux. Sans base pour la différenciation, la distinction entre notre douleur et celle d’autrui se dissout.
Par conséquent, il devient irrationnel de nous protéger de la souffrance tout en négligeant de protéger les autres. À la lumière de cela, il devient évident que, puisque la souffrance est quelque chose à éradiquer, la souffrance d’autrui doit également être atténuée, car la douleur est la douleur, quel que soit l'individu qui l'éprouve.
Quelle justification existe-t-il pour éliminer seulement notre souffrance et non celle d’autrui ? Ce serait une grave erreur de croire qu'une telle distinction existe.
Strophe 103 :
Pourquoi faut-il arrêter les souffrances
De tous les êtres ? Parce qu’elles sont incontestables.
S’il faut les arrêter, arrêtons-les toutes !
Sinon, pas plus la mienne qu’une autre !
Certains individus pourraient soutenir que s'il n'y a pas de soi pour percevoir ou endurer la douleur, alors la souffrance n'affecte intrinsèquement personne. Dans un tel scénario, pourquoi devrait-on atténuer la souffrance d’autrui ? Qu'est-ce qui devrait exactement être éliminé, et qui est là pour l'éliminer ? Il semble n'y avoir rien qui nécessite d’être éradiqué.
Cependant, cette ligne de raisonnement n'est pas entièrement valide. Bien que cela puisse être vrai au niveau ultime, au niveau relatif, nous faisons l'expérience de la souffrance comme quelque chose qui devrait être éliminé. Par conséquent, la souffrance d’autrui devrait également être atténuée. À l'inverse, si la souffrance d’autrui est considérée comme irrévocable, il s'ensuit logiquement que notre propre souffrance devrait également rester intacte. L'éliminer conduirait à une incohérence logique.
Ensuite, dans les stances 104 à 106, Shantideva réfute ces arguments contre l'égalisation du soi et de l'autre.
Strophe 104 :
Puisque la compassion entraîne de grandes souffrances,
Pourquoi se forcer à souffrir ?
À considérer les souffrances du monde,
En quoi celles de la compassion seraient-elles plus grandes ?
On pourrait suggérer que la contemplation des souffrances d'autrui évoque souvent en nous un sens profond et presque accablant de compassion. Cependant, compte tenu de l'objectif d'éliminer toutes les formes de chagrin, on pourrait se demander pourquoi il est nécessaire d'invoquer la détresse de la compassion, que ce soit en soi ou chez les autres.
En réponse à cela, on pourrait soutenir que notre attention devrait principalement se porter sur la contemplation de l'angoisse éprouvée par les êtres en enfer. Après tout, comment pourrait-on juger « l'aiguillon de notre compassion » intense lorsqu'il est juxtaposé à l'agonie atroce endurée par ceux dans de tels domaines ?
Strophe 105 :
Si la souffrance d’un seul
Élimine la souffrance d’un grand nombre,
L’être compatissant
La produira en lui et chez les autres.
Malgré la souffrance potentielle que l'on peut éprouver en raison de la compassion, celle-ci peut être comparée à une blessure nécessaire infligée au corps dans le but de guérir une maladie. Si l'atténuation de la multitude de souffrances endurées par d'autres repose sur la douleur singulière portée par un individu compatissant, alors les individus pratiquant amour et bonté doivent sans aucun doute cultiver une telle douleur en eux-mêmes et parmi leurs adeptes.
Strophe 106 :
C’est pourquoi, bien que sachant ce que le roi
Lui ferait subir, Supushpachandra(*)
Ne s’épargna point cette souffrance
Pour épuiser celle du grand nombre.
(*) Supushpachandra est un bodhisattva qui reçut une ordonnance royale le forçant de s'abstenir d'enseigner les enseignements du Bouddha. Pour le bien des êtres Il n’hésita pas à enfreindre la loi, ce qui lui valut d’être exécuté par le roi Shuradatta.
La nécessité de nourrir la douleur de la compassion est illustrée par le conte du Bodhisattva Supushpachandra dans le Samadhiraja Sutra. En dépit de sa connaissance clairvoyante de la menace imminente sur sa vie par le roi Viradatta, il a courageusement relevé le défi.
Ses actions altruistes, y compris le jeûne pendant sept jours, l'enseignement du Dharma, et la génération d'un immense mérite spirituel, ont conduit à l'élévation de nombreux êtres. Même après sa disparition tragique aux mains du roi, son histoire demeure un témoignage de la puissance transformatrice de la compassion désintéressée.
Un récit de son histoire peut être trouvé dans le Samadhiraja Sutra (**).
(**) Le Samadhiraja Sutra fut cité à plusieurs reprises dans cette étude du Bodhicaryâvatâra. Je propose donc de nous y arrêter quelques instants. Il s’agit d’un très important Sutra Mahayana.
En tibétain, intitulé « ཕགས་པ་ཅཇོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རངཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་སྤྲོས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ», qui est la traduction tibétaine de son titre sanskrit : « Ārya-sarvadharma-svabhāvasamatā-vipañcita-samādhirāja- nāma-mahā¬yānasūtra ». Ce titre peut être traduit en anglais par : « Le noble Mahāyāna Sūtra « Le roi des Samādhis, l'égalité révélée de la nature de tous les phénomènes »
Le Samadhiraja Sutra a été donné au Pic du Vautour près de Rajghir, en réponse à une demande présentée au Seigneur Bouddha Shakyamuni par le bodhisattva Candraprabha, lui demandant comment acquérir certaines qualités importantes des Bouddhas.
Le Bouddha répond qu'il existe « un seul dharma » qui conduit à ces vertus. Le Bouddha décrit d'abord le samadhi appelé « l'élaboration de l'identité dans l'essence de tous les phénomènes » à travers la brève déclaration suivante : « son esprit est égal envers tous les êtres, son esprit est bénéfique, son esprit est sympathique, son esprit n'est pas enclin à aux représailles, son esprit n'est pas vexatoire.
Le sutra énumère ensuite plus de trois cents descriptions de ce samadhi, telles que : la retenue du corps, de la parole et de l'esprit, la « pureté des actions », « le dépassement complet des supports », la « compréhension des agrégats », « l'indifférence envers le bases de conscience", "retrait des champs sensoriels", "abandon de l'avidité", "réalisation directe de ce qui ne surgit pas", "amabilité", "douceur", bonne conduite, manque d'aversion et d'attachement, connaissance des Vérités , l'enseignement, les connaissances analytiques, la connaissance des « divisions des mots et des syllabes », etc.
Ensuite, Shantideva décrit les avantages de la pratique de l'égalisation de soi et des autres.
Strophe 107 :
Lorsqu’on habitue son esprit de la sorte,
On prend plaisir à apaiser la souffrance des autres
Au point de pénétrer dans les Tourments insurpassables
Comme un cygne dans un lac de lotus.
Selon Shantideva, les individus habitués à percevoir l'égalité entre soi et autrui, trouvant de la joie à soulager la souffrance d’autrui, s'aventureront volontiers même jusqu'à l'Enfer de la Douleur Incessante. Ils le font avec le même enthousiasme bienheureux que les cygnes descendant gracieusement sur un lac charmant orné de lotus.
Strophe 108 :
Quand les êtres seront libres,
L’océan de leur joie
Ne me sufira-t-il pas ?
Comment lui préférerai-je ma libération ?
Certaines personnes soutiennent que ceux de la lignée des Sravaka sont exemptés de la nécessité de s'aventurer dans les royaumes infernaux, car leur quête assidue de la libération aboutit rapidement à une réalisation et à une joie accablante qui apaisent toute angoisse.
Shantideva, sur un ton quelque peu sarcastique, se demande si la joie sans limites découlant de la libération de tous les êtres sensibles n'est pas suffisante. Pourquoi ne devrait-on aspirer qu'à sa propre libération? À quoi sert une telle aspiration centrée sur soi? Quelle satisfaction peut-on trouver dans une félicité aussi fastidieuse?
Toutes les interprétations du texte soulignent que la libération dépourvue d'altruisme a peu de valeur. Comme le souligne le Shikshasamucchaya, "Pourquoi devrais-je m'efforcer d'une libération aussi fade?"
Strophe 109 :
Dès lors, j’œuvrerai au bien des autres
Sans orgueil ni admiration pour moi-même ;
Je n’aurai à cœur que le bien d’autrui,
Sans nourrir l’espoir d’aucune rétribution.
De plus, la noble entreprise de conférer des bienfaits aux autres sans la moindre trace d'égoïsme ne devrait pas servir de source de fierté menant au narcissisme. Ces efforts désintéressés, comme l'affirme Shantideva, sont intrinsèquement gratifiants en soi, dépourvus de toute anticipation de récompense future.
Strophe 110 :
De même que je me protège contre
Les désagréments les plus anodins,
J’aurai à l’esprit de protéger les autres
Et de les traiter avec compassion.
Shantideva conclut en affirmant que parce qu'il est essentiellement égal à tous les êtres, sans aucune disparité fondamentale, il étendra donc la même protection et le même soin compatissant envers les autres qu'il le ferait pour lui-même, réfutant même la moindre critique et les accusations infondées.
De plus, Shantideva invite à cultiver un état d'esprit de bienveillance, dans l'intention de protéger et de nourrir autrui. En outre, il introduira le concept de l'échange de soi pour les autres, en offrant d'abord une présentation générale de celui-ci dans les trois strophes qui suivent.
Strophe 111 :
Par habitude, je considère
Comme « moi »
Des gouttes de sperme et de sang
Étrangères et dépourvues de substance.
Certains pourraient soutenir que considérer les autres êtres comme soi-même est une notion inatteignable, que cet état d'esprit ne se matérialisera jamais. Cependant, il se concrétisera effectivement.
En ce qui concerne nos propres êtres, les gouttes de sperme et de sang de nos parents, bien qu'intrinsèquement étrangères, n'ont aucune existence authentique en tant qu'entités nous appartenant, ne servant ni de fondement à la libération ni à l'existence mondaine illusionnée. Pourtant, c'est uniquement en raison de la persistance de l'habitude que nous avons développé un sens de l'identité en relation avec elles.
Strophe 112 :
De même, pourquoi ne pas considérer
Comme « moi » le corps d’autrui ?
Et il n’est pas difficile, non plus,
D’assimiler les autres à mon propre corps.
Le fait que nous pouvons percevoir nos corps et nos esprits, bien qu’ils manquent d’existence intrinsèque, soulève la question : pourquoi devrait-il être difficile de considérer les corps d'autres individus (également issus des éléments générateurs de leurs parents) comme les nôtres et de s'habituer à ce point de vue?
À l'inverse, pourquoi, en raison d'un conditionnement habituel, devrait-il nous être difficile de contempler ce corps même qui est le nôtre comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre?
Strophe 113 :
Reconnaissant mes défauts
Et l’océan de qualités des autres,
Je m’habituerai à rejeter l’attachement au moi
Pour m’identifier à autrui.
Des figures spirituelles vénérées ont dénoncé la nature néfaste de l'attachement à soi et de la mentalité égocentrique et auto-indulgente qui constitue la cause fondamentale de la souffrance dans les vies présente et future.
De même, elles ont fait l'éloge des vertus incommensurables et sans limites qui donnent naissance au bonheur et au bien-être, un état élevé nourri par un amour altruiste désintéressé pour autrui.
À la lumière de cela, Shantideva exprime son intention de renoncer à toute égocentricité et de cultiver avec enthousiasme l'habitude de considérer les autres comme une extension de lui-même.
Le concept de l'échange entre soi et autrui, tel que délimité dans les écritures, diffère de celui pratiqué par les yogis. Par conséquent, bien qu'il existe quatre approches de cet échange (l'échange de l'attachement à soi-même, l'échange du corps comme base pour l'imputation de soi, l'échange de la joie et de la souffrance, et l'échange des actions négatives et positives), Shantideva ne fait allusion qu'aux trois premiers aspects.
Nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Je vous invite à pratiquer quelques instants la quiescence mentale, avant de dédier le mérite de cette session au bien de tous.